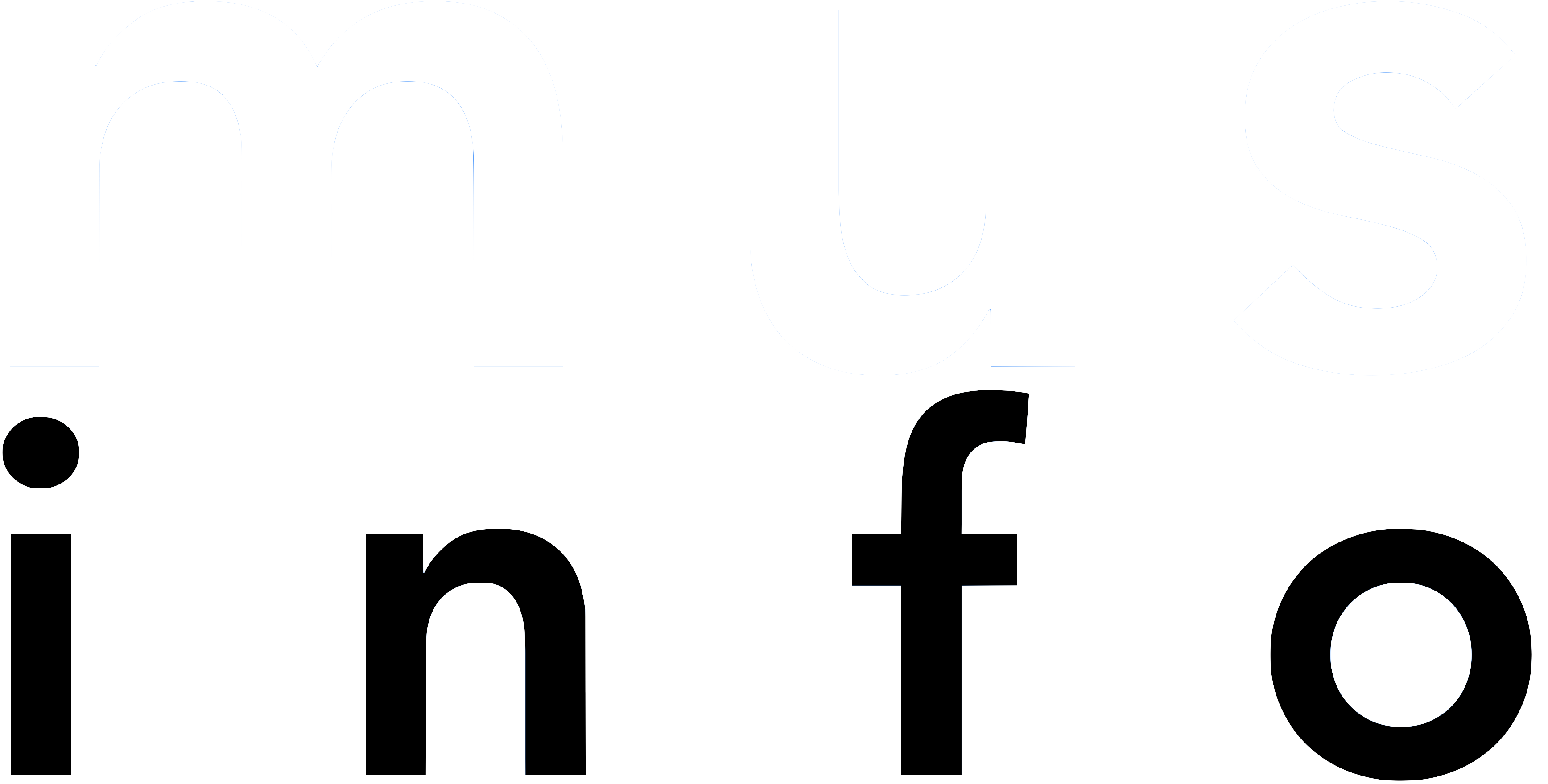Un léger retour de ciel
L’écoute à l’oeuvre chez Stefano Gervasoni
Est-il possible d’échapper à l’alternative entre modernité et postmodernité ? D’un côté, une musique fondée sur un matériau pur et homogène, tournée vers des formes de pensée et des sonorités nouvelles et visant sa propre autonomie — une musique de la connaissance ; de l’autre, une musique puisant librement dans l’ensemble des répertoires disponibles ses matériaux et ses formes, sans crainte du disparate, de l’hétérogène et de l’impur, une musique chargée de références — visant le plaisir.
Stefano Gervasoni apporte à cette question une réponse originale dans la mesure où sa musique subvertit de telles oppositions. Moderne, elle l’est à l’évidence par son écriture et par une inventivité sonore qui exige toutes sortes de techniques instrumentales et vocales inédites. Bien qu’on l’ait rattachée aux démarches de Lachenmann et Sciarrino, c’est pourtant moins le travail de déconstruction visant une critique du « beau son », ou le culte de l’inouï dans une perspective esthétisante qui la caractérisent, qu’une recherche de vérité expressive pour laquelle la subjectivité se défie des systématisations, des maniérismes et de la fausse spontanéité. Le territoire de la musique gervasonienne est celui d’une solitude qui affronte le réel, et pour laquelle la quête du nouveau, cette aventure de l’esprit, ne s’oppose pas aux formes de la mémoire.
Elle échappe ainsi aux dilemmes trop simplistes du progrès et de la régression, d’une objectivité oppressante et d’une subjectivité libérée, mettant en jeu la tension entre de tels contraires à l’intérieur même du matériau. La beauté sonore n’y masque pas les blessures que la réalité inflige : ni la projection dans un monde autre, ni les souvenirs du passé ne constituent des espaces purs. Dans le cycle inspiré par le mystique Angelus Silesius, In Dir, le compositeur fait chanter par les voix du choeur cette question existentielle : « Où se tient mon séjour ? Où moi et toi sommes. Où est ma fin ultime à quoi je dois atteindre ? Où l’on n’en trouve point. » On y perçoit l’écho du fameux Wohin ? schubertien, et la sentence terrible du Wanderer : « Là où tu n’es pas, là est ton bonheur ! » Au gré de cette errance, de cette recherche du lieu introuvable, Gervasoni fait resurgir ce qui, à l’intérieur du passé, demeure présent, mais sous une forme fragmentaire ; ce sont des bribes de mémoire.
Et c’est là une différence fondamentale avec l’esprit de la postmodernité : le passé, comme la beauté, ne nous sont pas restitués dans leur intégrité, mais voilés, morcelés, mutilés même, comme s’ils étaient rendus à la condition moderne qui fut la leur lorsqu’ils étaient pur présent. Ils portent en eux cet élément collectif et cette plénitude qui manquent à l’art d’aujourd’hui, et qui s’inscrivaient moins, autrefois, comme un accomplissement convenu que comme un idéal. En ce sens, bien qu’avec une sensibilité et des moyens totalement différents, Gervasoni est l’héritier inattendu d’un compositeur qui avait anticipé une telle démarche : Bernd Alois Zimmermann. Les formes du passé et celles de l’avenir sont convoquées dans un présent conçu à la fois comme durée pure, qui permet les moments d’illumination, et comme passage, qui débouche sur des formes éphémères.
Il y a chez Gervasoni plusieurs manières de se retourner sur le passé : par l’utilisation de matériaux élémentaires ou historiques comme les intervalles purs (la quinte juste par exemple) ou les accords parfaits ; par des bribes de citations que l’on n’identifie pas vraiment en tant que telles mais qui innervent le discours musical et contribuent à sa dimension expressive ; par des citations plus ou moins reconnaissables qui brisent la logique compositionnelle et modifient la perspective d’écoute ; enfin, par diverses sortes de transcriptions.
[...]
Veuillez lire la suite dans le numéro 115 de DISSONANCE (septembre 2011).